Catégorie : Santé & Prévention
Le ministère de la Santé a publié la nouvelle édition du calendrier des vaccinations. En 2025, plusieurs évolutions visent à mieux protéger les plus jeunes, les seniors, ainsi que les personnes à risque face à certaines maladies infectieuses.

Ce qu’il faut retenir sur le parcours vaccinal
- 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants nés depuis 2018 (diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B, ROR, Haemophilus influenzae B, pneumocoque, méningocoque C – remplacé désormais par ACWY et B).
- 8 rendez-vous et 13 injections jalonnent le parcours vaccinal de l’enfant.
- Pharmaciens, infirmiers, sages-femmes peuvent désormais prescrire et vacciner dès 11 ans.
- Le carnet de vaccination électronique, accessible depuis « Mon espace santé », permet de suivre ses vaccins et de ne manquer aucun rappel.
Nouveautés principales en 2025
| Nourrissons | – Méningocoque B : doses à 3, 5 et 12 mois. – Méningocoques ACWY : une dose à 6 mois + rappel à 12 mois (obligatoire jusqu’à 2 ans). Ces mesures remplacent l’obligation contre le méningocoque C. |
| Adolescents & jeunes adultes | – Vaccination recommandée contre les méningocoques ACWY (11–24 ans). – Vaccination contre le méningocoque B proposée entre 15 et 24 ans. |
| Dengue (zones concernées : Antilles, Guyane, Mayotte, Réunion) | – Pour les 6–16 ans ayant déjà eu la dengue. – Pour les 17–60 ans avec comorbidités. |
Vaccinations renforcées ou élargie
Pneumocoque : Dose unique recommandée à partir de 65 ans.
Coqueluche : Rappel recommandé pour les adultes > 25 ans proches de nourrissons ou en contexte épidémique.
Infections à VRS Vaccination recommandée pour :
- Femmes enceintes entre 32 et 36 SA,
- Personnes âgées de 65 ans ou plus à risque respiratoire ou cardiaque.
Papillomavirus (HPV)
- Pour les filles et garçons de 11–14 ans (2 doses).
- Rattrapage 15–19 ans (3 doses).
Mpox (ex-variole du singe)
- Vaccination réactive autour des cas ou chez les contacts immunodéprimés.
- Vaccination préventive pour les personnes à risque élevé.
N’hésitez pas à consulter le calendrier vaccinal 2025.
Rédactrice : Célia Fernandes, Assistante Chargée Marketing chez Bessé.
Catégorie : Santé & Prévention
La Direction Générale de la Santé (DGS) appelle à une vigilance importante face à la hausse des cas de rougeole en France et dans le monde.

A savoir
La vaccination est la meilleure protection pour éviter la propagation du virus et protéger les personnes les plus fragiles. Pour votre information, il existe un calendrier recommandations vaccinales.
Repérer rapidement les cas confirmés et diagnostiquer
La rougeole doit être détectée le plus tôt possible, surtout en cas de fièvre (≥ 38,5 °C), d’éruption sur la peau et de signes comme la toux, la conjonctivite ou la rhinite. Les patients sont contagieux 5 jours avant l’apparition de l’éruption et jusqu’à 5 jours après l’apparition de l’éruption.
Le diagnostic doit être confirmé par un test PCR ou par la recherche d’anticorps (IgM) à partir du 3ᵉ jour d’éruption.
Tout cas suspect doit être signalé rapidement à l’agence régionale de santé (ARS), même si les résultats ne sont pas encore disponibles. Les patients doivent être isolés, porter un masque et éviter les contacts.
Mesures pour gérer un cas suspect ou confirmé
Pour les personnes à risque (nourrissons, femmes enceintes, personnes immunodéprimées), des mesures de prévention doivent être proposées, comme la vaccination ou des immunoglobulines. Il est aussi important de vérifier si les personnes nées après 1980 sont bien vaccinées, et de les vacciner si besoin, surtout dans les 72 heures après un contact avec un malade.
Si une personne semble malade :
- Appeler et envoyer un mail à l’ARS rapidement,
- Remplir la fiche de déclaration et l’envoyer, même si tout n’est pas complété.
Les informations manquantes pourront être ajoutées plus tard.
Mesures de prévention pour les professionnels de santé et pour les voyageurs
Les professionnels de santé et ceux qui travaillent avec des enfants doivent avoir reçu deux doses du vaccin ROR. Les voyageurs qui partent dans des zones à risque doivent aussi être vaccinés.
Rédactrice : Célia Fernandes, Assistante Chargée de Marketing chez Bessé.
Catégorie : Santé & Prévention
A partir du 1er avril 2025, l’Assurance Maladie renforce le programme M’T dents pour améliorer la prévention bucco-dentaire, suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ce programme devient annuel pour les jeunes de 3 à 24 ans, qui bénéficieront chaque année d’un examen de prévention et des soins nécessaires. L’Assurance Maladie prend en charge 100% des frais, sans avance de frais.
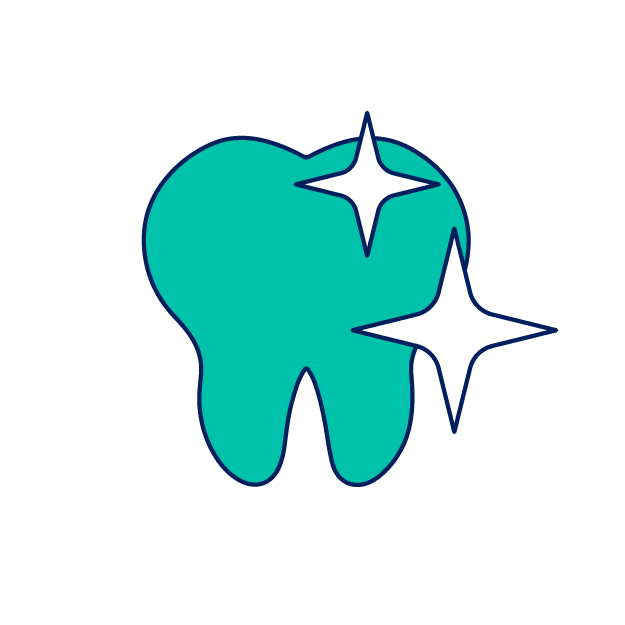
A savoir :
Les soins d’orthodontie ne sont pas couverts, mais si des soins dentaires sont nécessaires dans les 6 mois suivant le rendez-vous, l’Assurance Maladie prend en charge 60% et la complémentaire santé le reste. Un examen bucco-dentaire est aussi proposé aux femmes enceintes, du 4e mois de grossesse jusqu’à 6 mois après l’accouchement
Une prévention dentaire annuelle pour les jeunes jusqu’à 24 ans
Tous les ans, à l’occasion de l’anniversaire de l’enfant, les parents ou le jeune majeur reçoivent une invitation par mail pour un rendez-vous gratuit chez le dentiste de leur choix. À l’âge de 3, 6, 12 et 18 ans, un courrier postal sera envoyé.
Le rendez-vous peut être effectué durant 1 an à compter de la date anniversaire.
Documents à apporter :
- La carte Vitale du bénéficiaire
- Le carnet de santé
- La carte de complémentaire santé, si applicable
Le formulaire de prise en charge a été supprimé.
En quoi consiste la consultation M’T dents ?
L’examen comprend obligatoirement :
- La détection de facteurs de risques (succion du pouce, tabagisme, consommation de sucre…)
- Un examen bucco-dentaire complet
- Des conseils sur l’hygiène dentaire (comme le brossage)
- Si nécessaire, un programme de soins dans les mois suivant l’examen
Catégorie : Santé & Prévention
Une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 commencera au printemps 2025 pour protéger les personnes âgées et vulnérables, selon la Haute Autorité de santé (HAS). Elle vise les personnes à risques de formes graves de la Covid-19, surtout avant l’été, lorsque le virus a circulé ces dernières années.
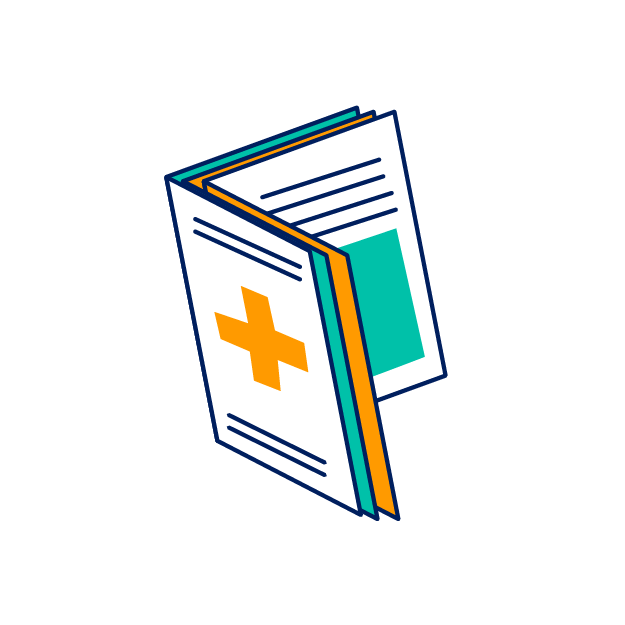
A savoir :
Pour plus d’informations sur la dose annuelle de vaccin contre la Covid-19, consultez la fiche sur Service-Public.fr : “Vaccin contre la Covid-19 : quelles sont les règles ? “
Les personnes concernées par cette campagne sont :
- Les personnes âgées de 80 ans et plus
- Les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge
- Les résidents en Ehpad (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ou en USLD (Unités de Soins de Longue Durée), peu importe leur âge.
- Les personnes considérées à très haut risque sur la base de leur situation médicale spécifique, après une décision partagée avec leur équipe soignante
La campagne de vaccination se déroule du 14 avril au 15 juin 2025, avec une possible prolongation jusqu’au 15 juillet 2025 selon la situation épidémiologique.
Le renouvellement vaccinal pourra se faire 3 mois après la dernière injection ou infection à la Covid-19.
Les résidents d’Ehpad et d’USLD recevront le vaccin sur place. Les autres pourront se faire vacciner par leur médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme ou dans les services hospitaliers.
Catégorie : Santé & Prévention

« Il n’y a rien de plus ridicule d’un médecin qui ne meurt pas de vieillesse » Voltaire
A noter :
La campagne DIS DOC T’AS TON DOC ? doit continuer à sensibiliser tous les médecins.
L’APPA s’y associe pleinement tout comme elle l’avait déjà fait en 2017 et elle incite tous ses adhérents à choisir un médecin traitant pour :
PRENDRE SOIN DE CEUX QUI NOUS SOIGNENT
DIS DOC, T’AS TON DOC ?
La SFAR (Société Française d’Anesthésie Réanimation) relance la campagne pour changer le modèle culturel des médecins, en incitant les partenaires à reprendre cette campagne qui avait démarré en 2017.
Cette dernière, initiée par notre ami et collègue le Dr Max DOPPIA au sein du CFAR (collège Français des Anesthésistes Réanimateurs) a pour but de supprimer la pratique de l’automédication et de l’autodiagnostic. « prendre soin de ceux qui soignent ».
L’objectif pour 2027 : un suivi médical pour 100% des médecins.
Le constat : 80% des médecins n’ont pas de médecin traitant, 68% déclarent avoir renoncé à s’arrêter, 30 à 45% des personnels médicaux seraient en burn-out. L’autoprescription et l’autodiagnostic sont très souvent sources de retard de prise en charge et il est difficile d’en connaître les limites. L’image du médecin « surhomme » reste prévalente.
Il faut faire prendre conscience aux médecins qu’ils méritent de bénéficier du système qu’ils souhaitent pour leurs propres patients. Mais quand on prend en charge un confrère, cela nécessite une approche différente car ce n’est pas un patient « lambda » car il sait !
Cette campagne simple par son libellé est devenue internationale, appréciée et soutenue à l’étranger, au Canada (PAMQ Programme d’aide aux médecins du Québec ), au Catalogue, en Suisse… Elle s’intègre pleinement dans la Qualité de Vie au Travail (QVT). Elle a été relayée et soutenue en France par les autorités et acteurs institutionnels :
- Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
- Centre National de Gestion
- Agence Nationale du Développement Professionnel Continu DPC
- Haute Autorité de Santé HAS qui a intégré la QVT dans une des dimensions de la Certifications
- Les ARS
Des publications et de nombreuses thèses relatent la pratique de l’automédication des médecins et le manque de suivi de leur propre santé. Cependant on remarque quelques évolutions ces dernières années, comme une association qui s’est organisée pour prendre en charge la santé des soignants et à créer une consultation dédiée aux médecins du département du Gard.
- 68% des médecins libéraux des Hauts de France sont favorables à la création d’une structure type médecin du travail.
- Les plus jeunes sont plus aptes à prendre un médecin traitant, les femmes et les internes aussi.
- Ces médecins appliquent à eux-mêmes les recommandations de l’HAS.
Des pistes pour l’amélioration peuvent être envisagées :
- Que la médecine du travail soit plus active à la fois pour les salariés mais qu’elle puisse exister pour les libéraux.
- Encourager les étudiants à se faire suivre par un médecin traitant, les sensibiliser sur leur propre suivi de santé mentale et psychologique dès le début des études médicales.
- Envisager un DPC sur le thème « prendre soin de soi »
- Que les assureurs des risques professionnels puissent peut-être avoir un rôle de formation et d’aide.
L’objectif de 2027 sera-t-il atteint ? Les pratiques d’autodiagnostic et d’automédication seront-elles un jour en voie de disparition ?
Catégorie : Santé & Prévention
Originaire du Finistère, « au bout du bout de la Bretagne », Killian L’helgouarc’h à la ténacité de ses origines qu’il met aujourd’hui au service de l’InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) dont il assure la présidence depuis septembre dernier, en parallèle de la fin de son internat à Béziers. Logement, temps de travail, santé mentale : c’est le programme de son mandat qu’il exprime d’une voix aussi tranquille qu’assurée afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des internes…


Quelques chiffres issus de l’Enquête nationale santé mentale (ISNI, ISNAR-IMG et ANEMF, 2024), sur 8 307 réponses en ligne (internes & externes) :
- 52% des répondants souffrent de symptômes anxieux et 66 % se sentent en état de burn-out.
- 21 % ont affirmé avoir eu des pensées suicidaires pendant l’année ; 19% ont déclaré consommer ou avoir déjà consommé des « anxiolytiques ».
- 24 % ont des symptômes de troubles du comportement alimentaire et 16 % ont exprimé avoir une consommation excessive d’alcool.
- 14% des répondants ont affirmé avoir subi « des humiliations répétées » au cours de leur cursus.
- 26% des internes, 19% des externes et 8% des étudiants de préclinique ont été victimes de propos ou attitudes à caractère sexuel les mettant mal à l’aise ; plus de 500 agressions sexuelles ont été rapportées dans le cadre de l’enquête.
- 10% des répondants déclarent penser quotidiennement à arrêter la médecine.
Pour en savoir plus : isni.fr
Pouvez-vous nous raconter votre parcours en médecine et votre engagement syndical ?
J’ai fait mon externat à Brest et je suis à présent interne, en médecine générale à la faculté de Montpellier Nîmes. Je me suis toujours engagé dans le cadre de mes études, dès le collège où j’étais délégué de classe et jusqu’à la fac de médecine. Cela a commencé avec le Tutorat à Brest car c’était important pour moi de redonner d’une certaine manière le temps et l’accompagnement dont j’ai bénéficié à l’entrée à l’université. A Brest, le tutorat en médecine, c’est une vraie « institution » : tout le monde le fait et le dispositif est entièrement géré par les étudiants avec juste un appui pour l’administratif. Je suis donc devenu tuteur dès la deuxième année et je me suis lancé, dès l’année suivante, dans la gestion du tutorat en lui-même. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. On a fait avancer les choses pour les premières années. On a mis en place un service de cours gratuits et une plateforme pour les QCM afin que tous les étudiants puissent s’entraîner sans passer par une prépa privée. Du haut de mes vingt ans, à l’époque, c’était une belle première expérience de management et de gestion des problèmes au quotidien. A la suite, j’ai pris des engagements au niveau national, comme trésorier de l’ANEMF (Association Nationale des Étudiants en Médecine de France) et au sein du Conseil d’Administration de mon Université. Quand je suis parti à Montpellier pour mon internat, j’ai tout de suite rencontré le syndicat local dans lequel j’ai pris des responsabilités, jusqu’à en exercer la Présidence. J’ai alors décidé de candidater à la tête de l’ISNI et j’ai été élu, avant l’été.
Comment voyez-vous ce nouveau rôle et quels sont vos chantiers prioritaires ?
A l’ISNI, on a un mandat très court (un an) alors que nos interlocuteurs restent plus longtemps à l’exception, ces temps ci, des ministres ! Cela implique, de façon générale, d’inscrire son action dans une certaine continuité en poursuivant le travail sur des dossiers de fonds qui se construisent dans la durée. Ce n’est pas la première fois que l’ISNI choisit un interne en médecine générale, mais c’est un très bon signal dans le contexte de la réforme de la quatrième année d’études de Médecine générale.
Par ailleurs, l’ISNI se mobilise également fortement sur la question du logement des internes. Certains internats sont vraiment en état d’insalubrité, comme celui de Clermont-Ferrand qui est dans une situation catastrophique : dégâts des eaux, prises électriques hors normes, présence de nuisibles, etc. Certains étages sont même condamnés car ils ne sont plus habitables.
« Au-delà des cas extrêmes, le logement des internes est un enjeu d’attractivité globale pour les carrières médicales et pour les territoires ».
Il est primordial de pouvoir bien accueillir les internes, sur leur lieu de stage, afin qu’ils aient de bonnes conditions de vie et de travail. Un bon cadre de vie pourra aussi leur donner envie de revenir sur tel ou tel territoire, en tant que remplaçant, voire de s’y installer… C’est donc un véritable enjeu au-delà de la nécessité d’offrir à minima un logement décent à chacun !
Parmi les autres préoccupations majeures de l’ISNI, il y a bien sûr le sujet de la santé mentale des internes. Il y a quelques semaines, nous avons publié les résultats de notre nouvelle enquête nationale, en partenariat avec l’ANEMF et ISNAR-IMG, qui montre que la situation ne s’améliore pas, alors que nous sommes sortis de la crise sanitaire. Nous allons donc mettre les bouchées doubles sur ce sujet, en travaillant notamment sur les enjeux de la prévention, dès le début des études et même avant. Il paraît nécessaire d’ancrer cet enjeu de prévention dans tout le processus de formation afin de mieux détecter les premiers signes de détresse psychologique.
« On vit toujours avec cette idée que les médecins ne sont jamais malades, alors que c’est justement une population sujette aux risques de souffrance, de dépression voire d’idées suicidaires. Il faut la combattre et faire de la prévention, à tous les étages… »
Quels sont les grands enseignements de cette étude ?
La chronologie de l’étude est d’abord importante pour voir comment les choses ont évolué, trois ans après la précédente édition, réalisée en pleine pandémie. On aurait pu penser que la situation se serait améliorée depuis, mais cela n’est pas le cas, même si elle ne semble pas s’aggraver pour autant. Quoi qu’il en soit, on constate autant de syndromes anxieux en 2024 par rapport à 2021, ce qui n’est pas forcément étonnant quand on voit le nombre de réformes systémiques qui s’enchaînent, souvent dans la précipitation, et créent de l’incertitude voire de l’angoisse pour les étudiants.
« L’autre donnée qui m’interpelle, c’est la forte proportion d’étudiants ou d’internes qui a déjà envisagé d’arrêter : seulement 3 répondants sur 10 déclarent n’y avoir jamais pensé ! Tout le monde sait que la formation en médecine est très difficile, mais pas au point de se demander si on est en capacité de poursuivre, alors qu’on a un cruel besoin de médecins sur l’ensemble du territoire ! «
C’est un vrai souci qu’il faut absolument appréhender pour ne pas risquer d’en perdre davantage car, en cas d’abandon, tout le monde est perdant…
Quelles sont les solutions proposées par l’ISNI ?
La question de la santé mentale est très large car elle recouvre de nombreux domaines, souvent interdépendants. Pour faire le lien avec le logement, par exemple, une situation d’inconfort voire d’insalubrité risque d’accentuer une fragilité lorsqu’on rentre de 12 heures de travail mais qu’on ne peut pas se reposer convenablement en raison d’un dégât des eaux qui nécessite de faire des démarches plutôt que de dormir ! Le temps de travail des internes est aussi un facteur aggravant et un combat, sans relâche, de l’ISNI. Nous sommes en procès contre tous les CHU de France et en médiation avec un tiers d’entre eux pour essayer de trouver une solution permettant de décompter véritablement le temps de travail. Cet enjeu de décompte est une question épineuse avec les hôpitaux car c’est une nouvelle philosophie et un nouveau paradigme à prendre en compte dans l’organisation du travail. Elle pose pas mal de questions sur la continuité des soins et le suivi des patients lorsque les internes sont absents. Cela étant, ce décompte est indispensable si on veut pouvoir respecter le temps de travail hebdomadaire maximal de 48 heures, qui est déjà largement au-dessus de la durée légale en France. Il faut réussir à évaluer ce temps précisément pour essayer de comprendre pourquoi il est dépassé et trouver les solutions adéquates, le cas échéant, pour le diminuer. On sait par ailleurs que cela est possible : il y a des services ou des établissements qui respectent le temps de travail ainsi que les deux demi-journées hebdomadaires de formation prévues pour les internes dans le cadre de leur cursus.
Concrètement, à côté des actions judiciaires et des démarches de médiation autour du décompte, l’ISNI réalise un recensement des services qui respectent le temps de travail des internes et leur permet de continuer à se former dans de bonnes conditions. Il sera publié dans le courant de l’année avec l’objectif d’identifier les leviers, comme les freins à surmonter, pour y arriver, même dans les services où le temps est plus compliqué à gérer, comme en chirurgie.
Pour finir sur la santé mentale, l’enjeu collectif consiste également à lever l’omerta sur le sujet et sur la souffrance à l’hôpital, mais j’ai l’impression qu’on commence à en prendre le chemin.
« Il faut poursuivre dans cette voie, continuer à expliquer que la fragilité psychologique peut aussi faire partie de l’exercice de la médecine et que les internes, comme les praticiens, ne sont pas invincibles, loin de là ».
Il faut faire de la prévention, les sensibiliser sur leur propre suivi médical et faire de la pédagogie, à tous les niveaux. On cherche par exemple à trouver des moyens pour que les cheffes de services, qui encadrent les internes, soient mieux formés sur l’ensemble des facteurs de risques (temps de travail, harcèlement, violences sexistes ou sexuelles, etc.). En tant que responsables d’internes et de services tout entier, l’enjeu est qu’ils puissent détecter les problèmes en amont, plus facilement et plus rapidement, avant d’en arriver à des situations irréparables…
Parmi les préconisations de l’ISNI, il y a le développement des « échanges entre pairs, sur le modèle de l’internat de médecine générale. » En quoi cela consiste ?
Ce dispositif a effectivement été mis en place en médecine générale pour organiser des réunions régulières entre les internes, supervisées par un maître de stage universitaire. L’idée, c’est que chaque interne puisse se livrer davantage sur une situation qui lui a posé problème au cours de sa formation. La démarche a plusieurs avantages : pour l’interne concerné, elle peut avoir un effet cathartique en revenant sur un épisode personnel difficile ; et au contact des autres, elle permet d’échanger et de se donner des conseils, tout en montrant qu’on n’est pas seuls face à une situation que les collègues ont surement déjà rencontré… Ces échanges permettent donc de communiquer sur les pratiques cliniques, mais aussi sur la gestion en tant que telle d’un problème.
« Pour moi, la prévention en santé mentale, c’est aussi et souvent une affaire de communication, lorsqu’un interne, par exemple, n’a pas voulu ou n’a pas pu exprimer une difficulté auprès de ses supérieurs. A la place, il peut penser qu’il n’est pas bon, voire douter de ses propres capacités au travail, alors que le problème aurait pu être désamorcé rapidement, simplement en débriefant et en le rassurant si besoin.«
Donc, oui, je pense que c’est un bon système de favoriser les échanges entre les internes et de développer ce type de démarches. C’est important de rappeler qu’un interne peut se tromper et que c’est même tout à fait logique : nous sommes des professionnels en formation, nous sommes là pour apprendre, mais ce message est encore plus efficace quand on peut le relayer à plusieurs et en échangeant avec ses propres collègues…
Malgré l’instabilité gouvernementale, le Ministère de la Santé est à nouveau dirigé par un praticien. Est-ce que cela vous semble positif pour faire avancer ces sujets ?
Effectivement, Dr Yannick Neuder est cardiologue au CHU de Grenoble et a toujours continué à exercer à côté de sa carrière politique. C’est toujours apprécié d’avoir un ministre médecin. On a le même logiciel, on a fait les mêmes études, donc c’est toujours plus facile d’échanger sur l’ensemble de ces sujets qu’il connaît de l’intérieur. D’ailleurs, à l’ISNI, on avait déjà eu l’occasion d’échanger avec lui avant qu’il soit nommé, notamment sur le temps de travail ou les cas de départs à l’étranger. Au-delà de son profil, j’espère surtout qu’il sera en poste le plus longtemps possible afin qu’on puisse discuter et avancer dans la durée. C’est ce qui est compliqué, actuellement : six ministres se sont succédé depuis moins de deux ans et, à chaque changement, on perd beaucoup de temps pour se rencontrer, se présenter et se replonger dans les dossiers, sans garantie de pouvoir aboutir à des avancées concrètes en raison de l’instabilité politique.
Avez-vous un message « de santé » à faire passer en direction des internes pour 2025 ?
Mon principal message serait de :
« Penser à soi-même pour bien soigner les autres.«
Il faut d’abord parvenir à trouver son propre équilibre personnel pour être bien, au quotidien, dans son travail. C’est logique et cela ne repose pas seulement sur une démarche individuelle ; au contraire on voit que le collectif est toujours très important à l’hôpital et que les jeunes générations aspirent à travailler davantage ensemble, avec les autres spécialités, mais également avec les autres professionnels de santé. C’est vraiment une volonté commune que je trouve très moderne, donc il faut s’en servir pour faire changer les choses et aller encore plus loin, en prenant à la fois en compte le bien-être individuel et la force du collectif.
Catégorie : Santé & Prévention

A noter :
L’assurance maladie propose des mesures pour soulager les symptômes du zona, en particulier la douleur. Il est recommandé de :
- Prendre des douches ou des bains à l’eau tiède, deux fois par jour, avec un savon surgras.
- Appliquer des pansements simples sur les lésions, si possible.
Le zona est la manifestation d’une réactivation du virus de la varicelle, le plus souvent chez les adultes âgés de plus de 50 ans. Elle se caractérise par l’apparition de vésicules sur la peau, parfois éprouvante. Souvent bénigne, cette infection localisée peut-être invalidante par ses complications, en particulier des douleurs qui peuvent persister longtemps après l’éruption, notamment chez les personnes âgées et les immunodéprimés.
Les zones les plus fréquentes sont le thorax, le cou, le visage, l’abdomen et parfois les organes génitaux.
Le zona guérit en général en 2 à 3 semaines.
Les traitements du zona visent à soulager la douleur et à éviter que celle-ci devienne chronique.
Désormais, il existe une vaccination anti-zona.
Aussi à partir du 14 décembre 2024, l’Assurance maladie rembourse à 65% le vaccin Shingrix contre le zona pour :
- Les personnes de 65 ans et plus,
- Les adultes de 18 ans et plus ayant un système immunitaire affaibli, que ce soit à cause de maladie (comme le VIH) ou de traitement (comme les immunosuppresseurs).
Ces 2 catégories de personnes pouvaient déjà bénéficier depuis mai 2024 d’une prise en charge par l’Assurance maladie de cette vaccination, mais uniquement dans certains établissements de santé, comme les hôpitaux ou centres hospitaliers régionaux.
Il est par ailleurs conseillé de consulter votre médecin traitant pour confirmer le diagnostic de zona et adapter le traitement à votre cas.
Catégorie : Santé & Prévention
Vous êtes adhérents APPA et bénéficiez d’un contrat d’assistance négocié par l’APPA auprès d’Europ Assistance, vous ainsi que les membres de votre foyer, pouvez partir sereinement rejoindre votre lieu de vacances et profiter des activités estivales !

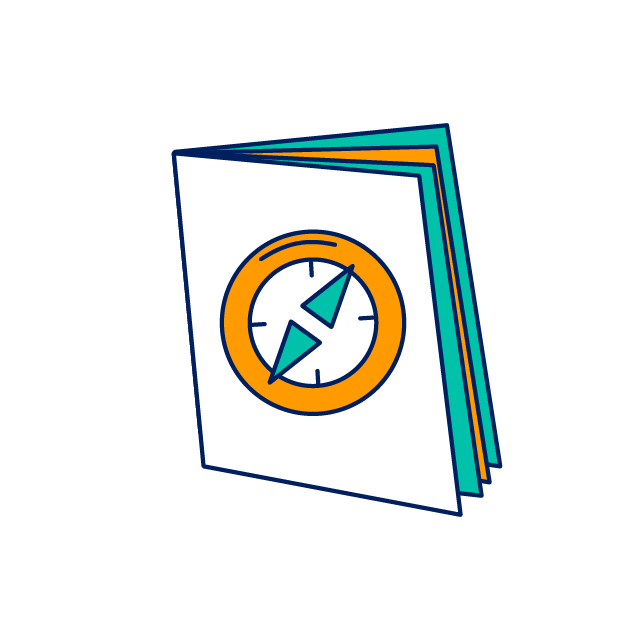
Pour connaître les garanties d’assistance
Le détail complet de vos garanties est accessible sur la notice d’assistance disponible sur votre espace adhérent espace-appa.besse.fr Le tableau des garanties
- Pour les adhérents en métropole : découvrez la fiche Garanties assistance
- Pour les adhérents des DROM : découvrez la fiche Garanties assistance
Vous avez des questions complémentaires ?
Les équipes de Bessé vous répondent au 09 69 36 37 10 ou par mail: gestion.appa@besse.fr
Dans le cadre du contrat APPA, vous bénéficiez de 2 niveaux d’assistance:
- Pour les garanties voyage : en déplacement en France ou à l’étranger, à plus de 50 km du domicile, pendant les 90 premiers jours du déplacement
- Pour l’assistance à domicile : en France
Un souci de santé pendant vos vacances à l’étranger ?
Pas de panique, votre assistance fait l’avance des frais d’hospitalisation selon les limites définies au contrat, procède au remboursement complémentaire de vos frais médicaux, et organise le rapatriement s’il est jugé nécessaire par les médecins d’Europ-assistance.
Les bénéficiaires avec lesquels vous voyagez ne sont pas laissés pour compte puisqu’eux aussi disposent des garanties de votre contrat d’assistance !
L’assistance APPA vous permet également, en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation au domicile, d’être accompagné et soulagé concernant l’organisation de votre quotidien : accompagnement chez un proche et garde des enfants, des animaux, aide-ménagère, aide-psychologique, soutien scolaire, sont prévus avec votre assistance APPA.
Important : l’intervention de l’assistance est toujours conditionnée à un aléa à caractère imprévu et soudain.
Les bons réflexes à avoir avant de partir
- Vérifier que votre contrat vous couvre dans le pays choisi et sur la durée de votre voyage
- Se munir de formulaires adaptés à la durée et à la nature de votre voyage (ces derniers sont délivrés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à laquelle vous êtes affilié(e))
- Photocopier vos numéros de passeport, carte d’identité et carte bancaire. Les conserver séparément
- Noter les numéros de vos clés. En cas de perte ou de vol cela peut toujours s’avérer utile
- Si vous êtes sous traitement, emportez vos médicaments et transportez les dans vos bagages à main pour éviter une interruption de traitement en cas de retard ou de perte de bagages.
- Et dans tous les cas, contacter Europ Assistance, pour toute mise en œuvre de prestations et avant d’engager toute dépense.

Sarah et Paul skient à Avoriaz. Sarah se tord la cheville. Paul, qui est médecin et adhérent de l’APPA, diagnostique une mauvaise entorse à son épouse. Sarah ne peut plus marcher et doit passer des radios, le couple décide d’interrompre leur séjour et de rentrer …
Ils doivent appeler APPA Assistance au 01 41 85 87 18 avant d’effectuer toute démarche
Vous bénéficiez de l’assistance « Europ Assistance » dédiée aux adhérents de l’APPA si…
- Vous êtes PH ou HU et vous avez souscrit au contrat santé et/ou prévoyance auprès de l’APPA ;
Voici les statuts hospitaliers concernés : les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les praticiens attachés, les praticiens adjoints contractuels, les PU-PH, les MCU-PH, les CCA-AHU, les assistants et les praticiens associés. - Vous êtes installé en activité libérale et avez souscrit au contrat santé auprès de l’APPA ;
- Vous êtes retraités et avez souscrit à l’option « assistance » en plus du contrat santé auprès de l’APPA
Vous disposez également d’un grand nombre de prestations complémentaires pour vous accompagner dans votre vie quotidienne, notamment, la Conciergerie APPA, une application mobile et une plateforme téléphonique d’Assistants Personnels pour aider les adhérents APPA résidant en métropole dans leurs recherches de prestataires.
La conciergerie connectée est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7 via l’application « Enfin lundi » disponible sur l’App Store et le Google Play Store, ou en contactant APPA Assistance santé au 01 41 85 87 18.
Catégorie : Santé & Prévention

A retenir
Quelques points sur les bronchiolites à VRS :
- leur fréquence hivernale,
- leur grande contagiosité,
- une population à risques, aux deux extrêmes de la vie,
- le facteur aggravant du tabagisme familial,
- une approche vaccinale récente par la prévention maternelle anténatale,
- une nouvelle molécule anticorps monoclonale élargie à toute la population de nouveaux nés.
- la préconisation vaccinale au-dessus de 75 ans (65 ans, si pathologie cardiaque ou pulmonaire chronique).
La bronchiolite est une atteinte des voies respiratoires inférieures d’origine virale. Le virus respiratoire syncytial (VRS) est la cause la plus fréquente, représentant environ 80 % des cas. Elle atteint les jeunes enfants, surtout lors de la première année, avec une saisonnalité hivernale, mais aussi les personnes âgées. Dans ces deux populations, des formes graves peuvent en résulter, bien que ces dernières soient minoritaires. Celles-ci surviennent préférentiellement chez des enfants prématurés, ou atteints d’affection cardiaque, pulmonaire… De mauvaises conditions socio-économiques et le tabagisme familial peuvent constituer des facteurs aggravants. Moins de 5% des enfants atteints seront hospitalisés et parmi eux une faible proportion en réanimation.
La période épidémique (Novembre à Mars, avec souvent un pic à l’issue des fêtes de fin d’année) constitue un défi d’accueil pour les services de Pédiatrie. On peut espérer que les nouvelles approches thérapeutiques amélioreront cette situation. Des recommandations ont été émises, cet été, par la HAS tant pour les nourrissons que les personnes âgées.
Prévention pour le nourrisson
Des mesures d’hygiène.. identiques à celles du Covid19…
La diffusion virale respiratoire ainsi que la haute contagiosité expliquent que les mesures préventives d’hygiène sont comparables à celles préconisées pour le Covid19 : aération des locaux, hygiène des mains, port du masque adéquat [cf. recommandations Sf2H, octobre 2024]
Elles doivent être appliquées, malgré les difficultés, dans les lieux de socialisation précoce (crèches, salles d’attente, transports en commun) mais ne suffisent pas toujours.
Les fêtes de fin d’année représentent un facteur important de dissémination virale. La prévention du tabagisme parental est également importante pour celle des formes graves.
La vaccination maternelle
La future mère, vaccinée durant la grossesse, peut apporter à son enfant, par voie transplacentaire, les anticorps protecteurs pendant au moins les trois premiers mois, période la plus à risque. Ce vaccin (Abrysvo) est recommandé au 8ème mois. Il s’ajoute aux recommandations concernant la grippe, le Covid19 et la coqueluche. Les 2 premiers peuvent être associés. Ils doivent avoir été effectués au moins 14 jours avant la naissance. Si ce n’est pas le cas (ou si refus vaccinal) une médication préventive peut être proposée, pour le VRS, après la naissance.
Prévention du nourrisson par anticorps monoclonal
La prévention passive par anticorps monoclonal (bloqueur des récepteurs VRS) est possible depuis de nombreuses années mais était réservée aux enfants à risque (grands prématurés, cardiopathies, mucoviscidose) pour des raisons de coût, mais surtout de répétition nécessaire des injections jusqu’en mars. Avec l’arrivée du Beyfortus, une seule injection suffit pour couvrir la période hivernale. Ceci a conduit les pouvoirs publics à la recommander pour tous les enfants sans protection vaccinale maternelle. Avec une telle approche on peut espérer que les formes nécessitant une hospitalisation deviendront rares. Pour cela il faut que les futurs parents, dont le choix est libre, en soient convaincus. Les professionnels de santé en charge de la grossesse ont un rôle important pour les convaincre.
Chez les personnes âgées
Le VRS peut provoquer chez les personnes âgées une détresse respiratoire aiguë et des complications graves, voire mortelles. On le sait depuis que l’on parvient à mieux identifier ce germe en pratique courante.
En juillet 2024, la HAS a indiqué que la vaccination est un moyen efficace de se protéger des formes graves et la recommande pour toutes les personnes âgées de 75 ans ou plus, ainsi que pour les personnes de 65 ans ou plus, présentant une pathologie respiratoire ou cardiaque chronique.
Deux vaccins existent : Abrysvo (Pfizer) et Arexvy (GSK). Le premier (seul autorisé pour la femme enceinte) est un vaccin bivalent recombiné sans adjuvant. Le second est monovalent avec adjuvant. Pour tous les deux, une seule injection suffit avec une efficacité de 60 à 80 % pour une couverture d’un an. Il n’y a pas encore de données concernant l’efficacité d’un rappel. Ces vaccins sont pris en charge par la Sécurité sociale.
Bien entendu l’APPA apporte son soutien à cette politique de prévention qu’elle recommande pour tous ses adhérent(e)s.
Catégorie : Santé & Prévention
Lancée en novembre 2023 à l’initiative de l’APPA, Coup de Blouse est la première plateforme d’information et de prévention sur la souffrance au travail, dédiée aux internes, praticiens, hospitalo-universitaires et à leurs proches. Depuis sa création, plus de 30 000 visiteurs uniques ont consulté le site qui propose, tout au long de l’année, de nouveaux contenus sur le sujet…
Pourquoi « Coup de Blouse »?
Selon une étude retentissante de l’association Soins aux Professionnels de Santé, publiée en 2016, 47 % des soignants interrogés déclarent ne pas savoir à qui s’adresser en cas de difficulté… S’il existe effectivement différents outils et moyens de contacts, généralistes ou ciblés, il n’est pas toujours évident d’identifier ceux adaptés à sa situation personnelle ou à celle d’un proche, parent ou collègue, en souffrance.
C’est l’un des objectifs principaux de l’APPA avec « Coup de blouse » : proposer une plateforme d’information unique, facile d’accès et adaptée aux besoins de la communauté médicale hospitalière.
« Coup de blouse » a ainsi été créé comme un centre de ressources en ligne pour aider les internes, les praticiens hospitaliers, hospitalo-universtaires ainsi que leurs proches à identifier les risques, les solutions concrètes et les organismes compétents en matière d’écoute, de prise en charge voire d’urgence. Il ne s’agit pas d’un service d’écoute ni d’accompagnement personnalisé, mais d’une plateforme d’information et de prévention sur la souffrance au travail à l’hôpital.
Que trouve-t-on sur « Coup de Blouse »?
La plateforme de l’APPA propose 4 types d’outils, régulièrement mis à jour, pour prévenir les « coups de blouse » :
- Des fiches pratiques sur les principaux risques psychosociaux à l’hôpital, souvent interdépendants, avec rappel du cadre (médical, juridique, organisationnel, etc.), solutions concrètes et liens utiles « pour aller plus loin ».
- Des « paroles » à travers un format d’interviews de personnalités engagées sur le sujet et une série podcast, « Coup de Blouse », pour recueillir et partager des témoignages de victimes d’épisodes de souffrance au travail.
- Une bibliothèque de ressources multimédia (voir, écouter, lire, naviguer) pour identifier et mieux comprendre les risques, les expériences, les solutions mobilisables par les victimes et par leurs proches.
- Des numéros et tchats d’écoute, d’accompagnement ou d’urgence, adaptés à la situation personnelle et professionnelle de chacun.
Un an plus tard, quel est le bilan?
Quelques données-repères sur la fréquentation et la communication autour de la plateforme :
- Plus de 30 000 utilisateurs uniques, soit environ 2 500 chaque mois en moyenne (plus de 80 par jour)
- Près de 2 000 écoutes cumulées pour les 3 premiers épisodes de la série podcast, disponibles sur le site et sur toutes les grands plateformes d’écoute (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc.)
- Des relais réguliers, sur les réseaux sociaux, par des associations d’internes ou de praticiens, des syndicats et d’autres médias ou organisations engagés, directement ou indirectement sur le sujet : Hospimédia, Podcast Santé, Santé Psy Jeunes, Éditions Delcourt, Psycom, Papageno, Musae, etc.
- Un support d’information de l’APPA matérialisant son projet associatif et son approche globale en faveur de la santé des internes et des praticiens. « Coup de Blouse » permet notamment de s’adresser aux nouvelles générations, à travers des contenus attractifs, comme les podcasts, et lors des événements médicaux.
Quels projets et contenus pour la suite ?
Pour ce premier anniversaire de « Coup de Blouse », une mise à jour complète est en cours. Elle sera étoffée, tout au long de l’année, par de nouveaux contenus permettant de compléter la bibliothèque de ressources ou les « paroles » des personnalités invitées.
L’APPA continue, au jour le jour, à promouvoir le site, à travers ses supports d’information, ses réseaux sociaux et ses partenaires.
Financée intégralement par l’association, la plateforme se matérialise également par un « kit d’information » disponible en accès libre sur le site à destination de la communauté hospitalière : affichettes imprimables, bannières et visuels libres de droits pour les réseaux sociaux, etc. Tous les établissements et organisations qui adhérent à la démarche peuvent les utiliser pour informer leurs publics concernés.
N’hésitez pas à les partager dans votre hôpital !
