Catégorie : A La Une
Praticien hospitalier en anesthésie-réanimation à l’hôpital pédiatrique et universitaire Robert Debré, à Paris, Dr Silvia Pontone a une carrière brillante et foisonnante entre le soin, la recherche, l’enseignement, les publications scientifiques et ses différentes responsabilités au sein de l’AP-HP. Correspondante locale de l’APPA, elle prend le temps de nous raconter son parcours qui nous fait voyager, la tête bien accrochée, de la néonatalogie à la démographie médicale, avec trois piliers : la rigueur, la passion et la transmission.

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
Je me suis orienté vers la médecine vraiment par vocation. Ce n’était ni un héritage familial ni une évidence sociale. J’ai commencé mes études à la fin des années soixante-dix, à une époque où la quasi-totalité des étudiants venait de familles de médecins ou de professions libérales. Ce n’était pas mon cas, loin de là. Dans mon environnement familial, il n’y avait aucun héritage médical, aucun réseau, aucun modèle à suivre… J’ai donc dû travailler beaucoup, m’accrocher et parfois me battre pour trouver ma place dans un milieu très codifié. Ceci dit, je n’ai jamais douté du sens de mon engagement et les efforts ont payé. La médecine représentait à la fois, pour moi, un engagement humain et une forme d’exigence intellectuelle. Très tôt, j’ai compris que ce serait un métier prenant, parfois rude, mais profondément utile et passionnant. Avec le recul, je pense aussi que certaines histoires personnelles jouent un rôle inconscient dans ces choix : il y a souvent, chez les soignants, un rapport intime à la fragilité, à la réparation…
Après avoir rejoint Paris pour votre internat, vous choisissez l’anesthésie-réanimation, une spécialité peu féminisée à l’époque…
Oui et je vous le confirme, ce n’était pas un choix évident dans les années quatre-vingt ! J’étais d’ailleurs la seule femme de ma promotion à choisir cette spécialité, qui n’était pas spécialement encouragée pour les femmes, ni vraiment valorisée. Je me suis souvent entendu dire : « ce n’est pas une discipline faite pour vous ! ».
Pourtant, c’est précisément ce qui m’attirait, car l’anesthésie-réanimation est au cœur de la médecine moderne : elle conditionne la chirurgie, la réanimation, les soins lourds ; elle impose une rigueur absolue, une capacité d’anticipation permanente et un travail collectif très fort.
C’est une médecine de l’ombre, mais sans laquelle rien n’est possible.
Pourquoi la pédiatrie et, plus précisément, la néonatalogie ?
La pédiatrie s’est imposée progressivement mais assez naturellement. Soigner des enfants, et en particulier des nouveau-nés, confronte à une médecine de l’extrême. Dans ces services, tout peut basculer en quelques minutes : les marges d’erreur sont infimes, les décisions doivent être rapides, justes, proportionnées. Au tournant des années quatre-vingt-dix, la néonatalogie était en pleine révolution, ce qui était vraiment passionnant. On commençait à prendre en charge des prématurés de plus en plus petits, de plus en plus fragiles. Aujourd’hui, on parle d’enfants qui peuvent peser 500 grammes à la naissance mais, à l’époque, c’était impensable ! Ces avancées ont été rendues possibles grâce aux progrès conjoints de la réanimation, de l’anesthésie, des médicaments et des techniques de ventilation. Être témoin mais aussi actrice de ces évolutions a été extrêmement marquant tout au long de ma carrière.
Votre parcours vous conduit en parallèle vers la recherche et la démographie médicale : pouvez-vous nous raconter comment ?
C’est vrai et cela peut surprendre, mais ce virage est né d’un constat très concret : à la fin des années quatre-vingt, une réforme du troisième cycle des études médicales avait réduit drastiquement le nombre de médecins formés. Sur le terrain, nous commencions déjà à percevoir des tensions, mais personne ne semblait mesurer les conséquences à long terme. Le sujet m’intéressait pour contribuer à comprendre et trouver des solutions. C’est ce qui m’a menée vers les biomathématiques puis vers la démographie médicale. À l’époque, la médecine fondée sur les preuves commençait tout juste à s’imposer. Appliquer ces méthodes à l’organisation du système de santé était essentiel….
Mon orientation vers un DEA, puis un doctorat de biomathématiques, au sein de l’école doctorale du Pr. Alain-Jacques Valleron a découlé de ma volonté d’évaluer le bénéfice des soins, notamment en anesthésie réanimation. A la demande de mon directeur, le Pr Jean- Marie Desmonts, j’ai consacré mon travail de recherche à la démographie médicale des anesthésistes-réanimateurs puis je l’ai extrapolée à l’ensemble des spécialités. C’est une thématique qui devait durer six mois mais qui ne m’a pas quitté… Dès 1991, j’ai également eu l’occasion d’engager des travaux sur le sujet sous la responsabilité de Nicolas Brouard, chercheur à l’Institut national d’études démographiques (INED). On a notamment fait un papier, qui a beaucoup circulé à l’époque au sein de l’Assemblée nationale, dans lequel on annonçait le déclin démographique des médecins qui allaient s’orienter vers l’anesthésie-réanimation. En 1995, l’année où je suis devenue PH, j’ai également été reçue au concours de l’INED pour devenir chercheur associée. J’ai également eu l’opportunité, la même année, de rejoindre la direction des affaires médicales de l’AP-HP, en tant que spécialiste du sujet.
Cette triple casquette entre la pratique médicale, la recherche et mes différents engagements au sein de la gouvernance des hôpitaux parisiens, constitue le fil rouge de ma carrière depuis trois décennies.
Quels ont été vos principaux champs de recherche à l’INED ?
Au sein de l’Institut, nous avons construit des modèles démographiques solides, basés sur des données objectives. Dès le début des années quatre-vingt dix, par exemple nous avons montré que si rien n’était fait, certaines spécialités en particulier l’anesthésie-réanimation allaient perdre jusqu’à 50 % de leurs effectifs en quelques décennies. Ces travaux ont parfois suscité de fortes résistances, car beaucoup de décideurs pensaient que ces projections étaient excessives ou alarmistes. Pourtant, au contraire, la démographie est une science très fiable : lorsqu’on connaît les flux d’entrée et de sortie, l’avenir est largement prévisible. Le problème, c’est que les décisions politiques ont souvent été prises avec dix ans de retard, ce qui est considérable, surtout pour une activité dont le temps de formation est très long… En parallèle, nous avons également travaillé sur de nombreux sujets pour lesquels la démographie médicale est déterminante en termes de politiques de santé, de stratégie de prévention et/ou de prise en charge. Ce fut notamment le cas pour l’épidémie de SIDA dans l’Afrique subsaharienne, à une époque où on annonçait plus de 40 millions de personnes séropositives sur le continent ! J’ai beaucoup travaillé sur le sujet et effectué notamment deux missions sur le terrain au Centre Pasteur de Yaoundé et à l’Institut Pasteur de Dakar.
En France, est-ce que les travaux auxquels vous avez participé ont eu des conséquences, directes ou indirectes, sur les politiques de santé ?
Oui, je pense, progressivement et parmi tout un ensemble d’avancées. Ils ont contribué à la mise en place de filières spécifiques pour certaines spécialités, à l’augmentation du numerus clausus, à la création d’observatoires de la démographie médicale. Cela a permis de limiter les pénuries les plus graves, notamment en pédiatrie ou en gynécologie. Mais il faut aussi rester lucide : si ces décisions avaient été prises plus tôt, les tensions actuelles seraient moindres, car la démographie ne pardonne pas l’inaction prolongée…
Est-ce que vous vous êtes posé la question, à un moment donné, de choisir entre le soin et la recherche ?
Non, à vrai dire, cela n’est jamais arrivé parce que je n’ai jamais voulu renoncer ni à l’un ni à l’autre.
La clinique me nourrit autant que la recherche, et réciproquement. J’ai toujours vécu entre deux temporalités : celle de l’urgence médicale, particulièrement en pédiatrie, et celle, beaucoup plus longue, de la recherche, des enquêtes, des analyses…
C’est exigeant, parfois épuisant, mais extrêmement formateur ; cette double approche permet de ne jamais perdre de vue la réalité du terrain, tout en évitant une démarche de recherche déconnectée du soin et de l’action.
Comment avez-vous vécu la crise sanitaire en tant qu’anesthésiste-réanimatrice et observatrice, depuis longtemps, des pénuries médicales ?
La crise du Covid a été une période extrêmement marquante pour moi, sur le plan personnel et professionnel. D’abord, j’ai été contaminée très tôt, dans les tous premiers jours de l’arrivée de la pandémie sur le territoire, à un moment où l’on ne comprenait pas encore bien ce qui se passait.
Au-delà de l’épreuve personnelle, ce qui m’a frappée, c’est la confirmation brutale des analyses scientifiques sur lesquelles nous travaillions depuis 25 ans. Si nous avions réellement perdu, sans réagir, 40 ou 50 % de nos effectifs médicaux et paramédicaux, le système hospitalier n’aurait tout simplement pas tenu ! Le fait d’avoir des ressources humaines encore suffisantes a permis de faire face, malgré les conditions de travail extrêmement difficiles. Pour moi, cela a donné un sens très concret à des années de travail d’anticipation souvent invisibles, mais dont la réalité de la crise a démontré toute l’utilité et, je l’espère, le rôle fondamental pour mieux s’y préparer…
L’enseignement est un autre pilier de votre carrière, pouvez-vous expliquer comment ?
Absolument, j’ai toujours enseigné, sans interruption, dans des cadres très différents, de la fac de médecine à Science Po. Pour moi, l’enseignement est également indissociable du soin et de la recherche ; et, en tant que praticien, je le considère même comme une responsabilité majeure pour transmettre la connaissance et l’expérience du terrain auprès des étudiants, des internes et de toutes les catégories de soignants. Ça l’est évidemment pour la prise en charge des urgences vitales et, plus généralement, pour tout ce que j’ai appris au cours de ma carrière à travers mes différentes activités, comme la physiologie du nouveau-né, la démographie médicale ou les bases de la prévention.
L’enseignement et la transmission sont absolument déterminantes dans notre métier, car ils permettent de préparer les nouvelles générations à exercer dans un monde médical de plus en plus complexe.
Avez-vous justement un message à transmettre à ces nouvelles générations de médecins ?
Je leur dirais simplement de chercher à faire ce qui leur donne du sens, sur le plan professionnel mais aussi personnel ; de ne pas avoir peur des parcours non linéaires, d’accepter les détours, les rencontres, les mondes différents, comme ceux que j’ai réussi à articuler à travers ma propre expérience.
Une carrière médicale, quelle qu’elle soit, est faite d’engagement, de doutes, parfois de renoncements, mais c’est aussi et surtout un formidable vivier d’opportunités et de rencontres humaines.
Si l’on travaille avec rigueur et passion, on ne s’ennuie jamais! Je peux vous le garantir…
Un mot, pour finir, sur votre adhésion à l’APPA ?
J’ai adhéré en 1996, quelques mois après être devenue praticien, à une période de ma vie où la protection sociale était également un enjeu essentiel. Ce qui m’a convaincu, c’est le modèle associatif, non lucratif et la capacité d’accompagnement personnalisé, mise en œuvre sur le long terme.
L’APPA n’est pas une mutuelle comme les autres : elle ne se limite pas à une logique de remboursement, car l’Association accompagne également les parcours, les carrières, les situations de vie – y compris dans les moments difficiles, tout en s’adaptant en permanence à l’évolutions des besoins sur le plan de la santé au sens large.
Je suis bien occupée dans mes différentes fonctions mais je suis heureuse de pouvoir y consacrer un peu de temps en assurant ce rôle de correspondant local, au sein de mon hôpital, pour faire connaître l’Association et répondre aux questions des collègues.
Rédacteur : Gabriel Viry, Directeur de l’agence KIBLIND.
Catégorie : A La Une
« Le centre hospitalier dit ‘général’ est un format d’établissement qui peut justement répondre aux attentes des nouvelles générations de médecins… »

Coup de Blouse
Créée à l’initiative de l’APPA, Coup de Blouse propose des témoignages, des outils et des contacts utiles pour aider les internes et les praticiens, ainsi que leurs proches, à prévenir une situation à risque de souffrance au travail. Plusieurs ressources concernent les conflits à l’hôpital et les moyens existants pour les résoudre.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Praticien endocrinologue au centre hospitalier de La Rochelle depuis plus de trente ans, Dr Thierry Godeau s’est toujours engagé au sein de sa gouvernance, en particulier à travers la présidence de la Commission Médicale d’Établissement (CME). Depuis 2016, il représente ses homologues, issus de près de 800 hôpitaux du territoire, dans le cadre de la Conférence nationale des Présidents de CME de centres hospitaliers, une voix qui porte et qui compte dans toutes les réflexions et décisions concernant la politique de santé. A quelques mois de la fin de son mandat et de son départ en retraite, le médecin nous rappelle le rôle déterminant des CME dans le fonctionnement quotidien et l’attractivité du modèle hospitalier général, notamment en direction des nouvelles générations…
Quel est votre parcours ?
Je suis Rochetais d’origine et je suis devenu praticien hospitalier en endocrinologie après mes études de médecine à Poitiers puis mon internat à Nantes. J’y ai commencé ma carrière en tant que chef de clinique puis je suis revenu à La Rochelle à la faveur d’un poste qui se libérait. J’y exerce donc depuis plus de 32 ans et je prends ma retraite en 2027.
Pouvez-vous nous raconter votre engagement au sein de la CME de l’hôpital ?
De façon générale, je me suis toujours impliqué, à titre personnel, dans la vie associative, par exemple dans le monde du basket, à l’échelle de mon club puis dans les différentes instances au niveau local, régional ou national, pour le compte de la Fédération. Au niveau professionnel, j’ai toujours eu le même besoin de m’engager au service du collectif et ce dès le début de ma carrière à La Rochelle. J’ai rejoint différentes commissions de l’établissement, comme celle des gardes, que j’ai présidé pendant 8 ans. Cela m’a amené à me présenter à la vice-présidence puis à la présidence de la CME où j’ai été élu en avril 2007. Le mandat est normalement de huit ans mais, lorsque l’établissement fusionne, les compteurs sont remis à zéro, ce qui a été fois deux fois les cas ici pour constituer notre Groupe hospitalier Littoral-Atlantique (La Rochelle – Ré – Aunis).
Comment êtes-vous devenu Président de la Conférence des Présidents de CME de centres hospitaliers ?
C’est un peu la même logique : je me suis engagé… Il y a des instances au niveau des présidents de CME à l’échelle régionale ; chaque région envoie des élus au niveau national, ce qui constitue une sorte de conseil d’administration regroupant une soixantaine de présidents de CME. Nous représentons au total près de 800 hôpitaux, à l’exception des CHU, des centres hospitaliers spécialisés (CHS) ont leurs propres regroupements. Je suis devenu président en mars 2016, c’est un mandat de quatre ans renouvelable mais il a été prolongé à six durant la crise sanitaire car ce n’était pas le moment propice pour organiser des élections ! J’aurais donc « officié » pendant dix ans car ma fonction s’achève au premier trimestre 2026.
Pouvez-vous nous rappeler le rôle d’une Commission Médicale d’établissement ?
Concrètement, c’est une instance de médecins élus au sein de l’hôpital qui représente toutes les catégories de professionnels : praticiens, titulaires ou contractuels, chefs de service, chefs de pôle, etc. A l’exception des chefs de pôle, qui sont membres de droit, tous les médecins sont élus. C’est donc une instance représentative du corps médical hospitalier dans son ensemble, qui donne des avis sur l’ensemble des sujets concernant l’établissement : le projet médical, la stratégie, les budgets, les investissements, l’attractivité, la qualité des soins, l’organisation du travail, les filières, les parcours, l’accueil des étudiants, la recherche, etc.
La CME a toujours un avis consultatif mais, au regard de sa légitimité et sa représentativité, il est extrêmement rare que la direction aille à son encontre, en particulier sur la stratégie médicale portée par l’établissement.
Le président de la CME est élu parmi les membres de la Commission. Au-delà du fait qu’il préside l’instance, sa fonction l’amène en réalité à coordonner et piloter le projet médical, supervisant la qualité des soins et assurant un ensemble de co-décisions avec la direction, comme la nomination à certains postes (chef de pôle, chef de service) ou la stratégie qualité. Sur ces sujets, on n’est pas dans la consultation mais dans une vraie démarche de co-décision.
Les textes n’ont volontairement pas fixé de procédure d’arbitrage, ce que signifie que le Président de la Commission et le directeur de l’hôpital doivent forcément trouver un accord car l’un ne peut pas décider sans l’autre : cela les oblige à travailler ensemble. Sur certains sujets, comme les finances, il n’y a pas obligatoirement de co-décision, mais le Président de la CME est généralement impliqué dans les autres instances de gouvernance. Par exemple, comme tous les PCME, je suis membre à titre consultatif du Conseil d’administration et vice-président du directoire du GH.
Et au niveau national, quelles sont les prérogatives de la Conférence nationale ?
Pour schématiser, la Conférence est partenaire de toutes les négociations avec le Ministère, la HAS et l’ensemble de structures intervenant dans la politique de santé. J’ai participé par exemple aux négociations pour le Ségur de la Santé avec les syndicats et la Fédération Hospitalière de France. Et cette semaine, j’avais rendez-vous avec le conseiller de santé de l’Élysée puis j’ai été auditionné au Sénat sur le projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale (PFLSS).
Bref, on est sollicité en permanence sur tous les sujets concernant la stratégie de l’hôpital public, la gouvernance, le management, l’attractivité, l’organisation des soins notamment dans les territoires et les conditions du travail dans les centres hospitaliers que nous représentons.
Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
Il y en a beaucoup, et en permanence… On a travaillé récemment sur l’attractivité de l’hôpital, les conditions d’exercice ou le sujet des astreintes avec les syndicats. Il y a aussi la question du rôle des Présidents de CME une fois qu’ils ont terminé leur mandat, ou comment le système de santé peut capitaliser sur cette expérience acquise afin de favoriser l’organisation des soins sur le terrain ? Par exemple, avec la Conférence, on s’est beaucoup mobilisé en faveur des GHT qui constituent selon nous un levier pertinent pour redonner une dynamique à l’hôpital public malgré les difficultés actuelles.
De quelques moyens disposez-vous pour assurer tout ces missions ?
Évidemment, la fonction au niveau national requiert beaucoup de temps et, en ce qui me concerne, je passe près de la moitié de la semaine à Paris. On a une petite enveloppe de fonctionnement, qui n’est pas très importante, mais elle permet de prendre en charge un secrétariat et un peu de logistique. Ceci dit, on manque clairement de collaborateurs.trices, notamment sur des sujets techniques qui nécessitent des expertises particulières et des notes stratégiques. C’est un vrai sujet que l’on essaie de faire avancer. On a beaucoup pesé ces dernières années sur l’évolution des textes concernant la gouvernance et le rôle des Présidents de CME, en particulier sur le sujet des conditions et la reconnaissance des moyens. En effet, jusqu’à maintenant, beaucoup de Présidents étaient un peu isolés dans leur établissement à exercer cette fonction à côté de leur métier de médecin sans avoir nécessairement de temps dédié. Donc on a fait avancer les choses, notamment à travers une vaste enquête, réalisée en 2018 que j’ai eu l’occasion de remettre en personne à Agnès Buzyn. Elle a permis d’aller vers la charte de gouvernance au sein des établissements, qui doit reconnaître les moyens mis à disposition du Président de CME : temps disponible, secrétariat, moyens logistiques et, plus généralement, son positionnement en tant que représentant de l’établissement à l’extérieur et auprès de la direction.
Pour revenir à la question des moyens, on estime, en moyenne, qu’un Président de CME doit y consacrer au moins la moitié de son temps. En réalité, c’est du cas par cas mais ce n’est pas forcément corrélé à la taille de l’établissement ; en effet, dans le cadre d’une plus grosse structure, Il est plus facile de constituer une équipe autour de soi pour pouvoir déléguer et se consacrer aux sujets plus stratégiques, ceux qui nécessitent d’avoir du recul, de constituer des dossiers, de préparer des réponses, impossibles à faire entre deux consultations ou deux opérations !
On parle beaucoup des conditions de travail des médecins et des risques psycho-sociaux à l’hôpital. Quel est votre regard sur le sujet ?
C’est un sujet protéiforme et complexe qui est d’abord celui des syndicats. Mais comme il concerne aussi l’attractivité médicale, les Présidents de CME sont forcément impliqués :
Si les conditions pour recruter des médecins ne sont pas remplies, il n’y a pas de médecin dans l’hôpital et l’hôpital ne tourne plus !
De façon générale, nous ne savons toujours pas très bien évaluer la charge de travail des médecins, ce qui est un premier sujet fondamental dans la mesure où c’est une profession dont les heures supplémentaires sont moins bien payées que les heures de travail normales. C’est une hérésie que l’on traîne depuis très longtemps et qui n’est toujours pas solutionnée alors que les attentes des nouvelles générations ont beaucoup changé. Pour les anciennes générations comme la mienne, on a sûrement accepté beaucoup de choses – peut-être un peu trop, au nom de la vocation et du « on n’est pas là pour l’argent »…
Or, aujourd’hui, le sujet majeur pour recruter est en partie liée aux rémunérations mais surtout aux conditions et à la reconnaissance de la charge de travail, ce qui implique d’abord d’avoir un dimensionnement convenable des équipes par rapport aux missions et aux besoins sur le terrain.
C’est un sujet sur lequel les jeunes sont beaucoup moins conciliants que nous et ils ont raison, car c’est un point déterminant de l’exercice qui a été laissé en jachère pendant de trop nombreuses années… C’est compliqué, mais il faut qu’on avance, en remettant les équipes au cœur des dispositifs. On a cru qu’on allait régler tous les problèmes avec les pôles, mais le moteur du réacteur de l’hôpital reste quand même l’équipe médico-soignante qu’il faut repositionner au centre de l’organisation.
Au-delà de la charge de travail, cela recouvre également le sujet de la capacité à décider. Si j’estime qu’on a bien fait avancer les choses pour la gouvernance au niveau dutop management, la situation s’est fortement dégradée en dessous…
Aujourd’hui, les médecins ont l’impression de ne jamais décider de rien !
Or, il faut qu’on réorganise cette décision en redonnant un peu de délégation et en répondant à des situations très concrètes : Quelles sont les marges de manœuvre d’un chef de service avec son cadre ? Quelles sont les marges de manœuvre d’un chef de pôle ? Quels sont les liens entre les deux et en définitive, quels sont les circuits institutionnels des décisions ? Il est nécessaire de clarifier tous ces circuits de décision et de faire avancer cela à l’échelle de l’établissement. Dans la loi RIST (2023), portée par notre nouvelle Ministre, il était justement question de remettre le projet de management et de gouvernance participatif au cœur du dispositif hospitalier mais, en réalité, cela n’a pas beaucoup avancé. Il y a beaucoup de résistance, ce qui renvoie à plusieurs problématiques, notamment au fait que les médecins ne sont pas bien formés au management. On a fait beaucoup de progrès, mais ce n’est pas encore satisfaisant. Et il y aussi un cercle vicieux car on a du mal, dans les CH, à trouver des volontaires pour prendre en charge des responsabilités de terrain, justement parce qu’ils ont aussi l’impression de ne rien pouvoir décider… La situation avance, il y a du mieux, mais c’est quand même très lent et ça va être un enjeu qu’il faudra continuer de porter dans les prochaines années, notamment à l’échelle de la Conférence, sur l’effectivité de cette gouvernance de proximité.
Malgré les difficultés, avez-vous un message à faire passer aux nouvelles générations de médecins sur l’exercice à l’hôpital ?
On ne va pas se mentir, les conditions sont parfois un peu difficiles.
On est aussi en train de réorganiser l’hôpital, notamment à travers les GHT qui vont le rendre plus attractif, autour d’équipes territoriales permettant aux médecins de se recentrer sur leur cœur de métier.
Au-delà des problèmes, il y a des solutions et l’hôpital reste quand même un lieu d’exercice formidable, celui du travail en équipe, de l’expertise, des cas complexes et de la recherche. C’est aussi le lieu de la transmission du savoir car on y forme les jeunes et on a tous été formés par des anciens. A l’échelle des CME et de la Conférence, on travaille beaucoup en direction des jeunes, afin de mieux leur faire connaître le centre hospitalier « général », durant leur formation, car c’est un lieu d’exercice très différent du CHU et beaucoup moins hiérarchique. En ce sens, je pense que ce format d’établissement est très attractif et peut justement répondre aux attentes de nombreux jeunes médecins…
Rédacteur : Gabriel Viry, Directeur de l’agence KIBLIND.
Catégorie : A La Une
Ce mois-ci, nous vous présentons le parcours de Dr Samia Touati, médecin réanimateur, élue à l’automne dernier au Conseil d’Administration de l’APPA.

Engagée et infatigable, Samia Touati a participé, de 2004 à 2017, à l’assistance médicale du Marathon des Sables, au Maroc. Une course à l’image de son dynamisme et de son énergie solaire que le Conseil d’Administration de l’APPA est heureux d’associer à ses nouveaux défis.
Présentation de son parcours :
Après ses études de médecine à Paris XIII, Samia Touati démarre sa carrière de praticien attaché puis contractuel à l’Hôpital de Meaux. Devenue praticien hospitalier à temps plein, en 2012, elle y exerce jusqu’en 2017 au sein du service de réanimation polyvalente puis dans l’unité de surveillance continue (USC). Après avoir rejoint le Centre Hospitalier Sud Francilien (91), elle change de mode d’exercice, durant deux ans, pour devenir médecin réanimateur remplaçante dans plusieurs hôpitaux sur l’ensemble du territoire : Saintes, Avignon, Perigueux, Creil, Nevers, Nemours, Bastia, etc. En novembre 2020, en pleine crise sanitaire, elle reprend son statut de praticien au sein du service de Réanimation Polyvalente du Groupe Hospitalier Public Sud Oise (60).
En parallèle de son activité à l’hôpital, cette parisienne passionnée n’a jamais cessé de se former, en continu, avec une douzaine de diplômes universitaires et qualifications à son actif, en lien avec la réanimation et la médecine d’urgence. Samia Touati participe également, de façon très active, à la vie quotidienne des établissements dans lesquels elle officie (conseil pédagogique, commission médicale, conseil de surveillance, etc.), tout en poursuivant l’encadrement des internes et des externes depuis le début de sa carrière. Elle a également enseigné, pendant dix ans, dans des Instituts de formation en soins infirmiers et participé à de nombreux projets de recherche, en tant que membre de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) depuis 2008, parallèlement à de nombreuses initiatives scientifiques collectives : protocoles cliniques multicentriques, communications sur les congrès médicaux, publications, etc.
Rédacteur : Gabriel Viry, Directeur de l’agence KIBLIND.
Catégorie : A La Une
Nous avons le plaisir de vous présenter le parcours de Dr Delphine Bourin, pharmacienne hospitalière engagée, qui vient de rejoindre le Conseil d’administration de l’APPA.
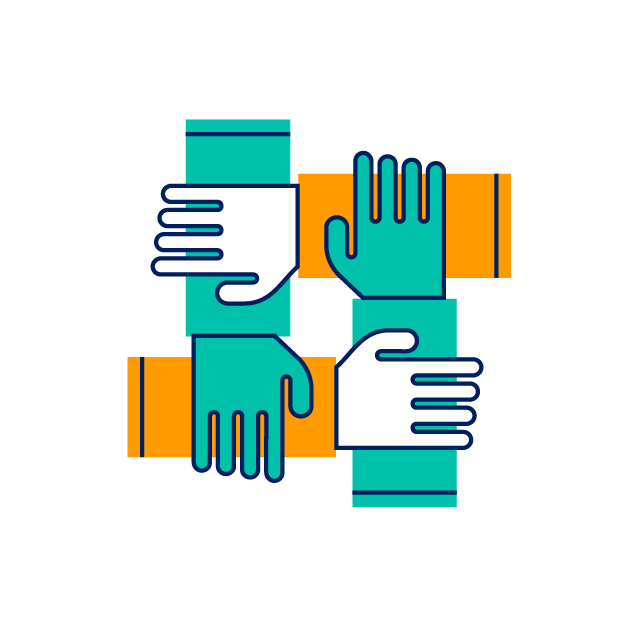
« Je suis adhérente à l’APPA depuis le début de ma carrière, ce qui m’a permis de mesurer l’aide apportée par l’Association, de façon très concrète, à certains confrères. L’intérêt de l’APPA pour la santé des praticiens hospitaliers, dans le cadre d’un projet associatif basé sur l’entraide et la solidarité, font écho avec mes valeurs et mes différents engagements professionnels.”
Dr Delphine Bourin
Présentation de son parcours :
Après ses études de pharmacie à Montpellier, Delphine Bourin fait son internat à Paris où elle reste pour exercer un poste d’assistante spécialiste à l’hôpital Saint-Louis, puis de pharmacien au sein de l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif.
En 1997, à 30 ans, elle intègre le Centre Hospitalier de Montfermeil et se spécialise dans le domaine des dispositifs médicaux. C’est un virage ou plus exactement un moteur, alimenté avec passion, pour la suite de sa carrière qui lui permet également de retrouver sa région d’origine, cinq ans plus tard, à la faveur d’une mutation. En 2002, la jeune femme devient ainsi responsable du secteur des dispositifs médicaux stériles et implantables au sein de la PUI du CHU de Nîmes.
Au-delà de son activité de praticien, Dr Delphine Bourin s’est toujours impliquée dans la vie professionnelle et associative à l’hôpital (enseignement, encadrements d’internes, etc.), mais aussi au service de sa spécialité. Depuis 2010, elle est membre de la commission technique d’Euro-Pharmat, la Société Pharmaceutique Française des Dispositifs Médicaux. En 2012, elle devient également déléguée régionale du syndicat regroupant les pharmaciens des hôpitaux (SYNPREFH), avant d’intégrer le Conseil d’Administration national depuis 2023.
Catégorie : A La Une
Créé en 2010, le Fonds d’intervention fait partie intégrante de la philosophie et du projet associatif de l’APPA. Dans ce cadre, un budget annuel de 75 000€ est voté, par le Conseil d’Administration, depuis dix ans. Avec cette action de solidarité, l’APPA œuvre au plus près des préoccupations de ses adhérents et de leur famille.

Comment bénéficier du Fonds d’intervention ?
En 2025 et pour la 8ème année consécutive, l’APPA a renouvelé sa dotation au Fonds d’Intervention à hauteur de 75 000 € !
Pour en savoir plus, cliquez ici.
A savoir
Sur 11 ans, le Fonds d’intervention c’est en moyenne : 60 762€ par an pour 37 demandes.
Le Fonds d’intervention peut être attribué à tout adhérent de l’association sur demande. Les dossiers de demande sont examinés de manière anonyme par une “Commission” de membres du Conseil qui se réunit tous les deux mois environ. Sont privilégiées les demandes de Fonds d’intervention pour handicap notamment si ce sont des enfants qui sont impactés. Le Fonds d’intervention vient aussi en aide dans de nombreuses autres situations dont les situations financières difficiles, les circonstances subites difficiles, le contexte de certains manquements de la CPAM aux remboursements, en implantologie, en optique, entre autres.
Cette action indépendante des contrats montre que l’APPA garde, chevillée au corps, des valeurs fortes de solidarité envers ses adhérents et reste à leur écoute ainsi qu’à leur côté à tout moment de leur vie.
Répartition des dossiers Fonds d’intervention par bénéficiaires en 2024
Quelques chiffres sur le Fonds d’intervention en 2024 :
- En 2024, le fonds d’intervention a permis de soutenir 27 confrères.
- Un financement à hauteur de 62 229€ (83% du budget voté en 2024).
Les principales demandes :
- Handicap (56%)
- Dentaire (23%)
- Soutien financier (9%)
- Audiologie (7%)
- Frais divers (4%)
- Optique (1%)
Constat 2024 vs 2023
- Une sollicitation plus forte sur le “Handicap” : 9 dossiers (4 en 2023).
- Une stabilisation des demandes en 2024 : 27 dossiers (25 en 2023).
- Une répartition par bénéficiaires équivalente à l’année 2023.
Rédacteurs : Danièle GOUMARD, Trésorière adjointe de l’APPA, Crespin ADJIDE, Trésorier de l’APPA
et Catherine PEPRATX, Chargée de mission associative chez Bessé.