
Entretien avec Dr Thierry Godeau, Président de la Conférence nationale des Présidents de CME de CH
« Le centre hospitalier dit ‘général’ est un format d’établissement qui peut justement répondre aux attentes des nouvelles générations de médecins… »
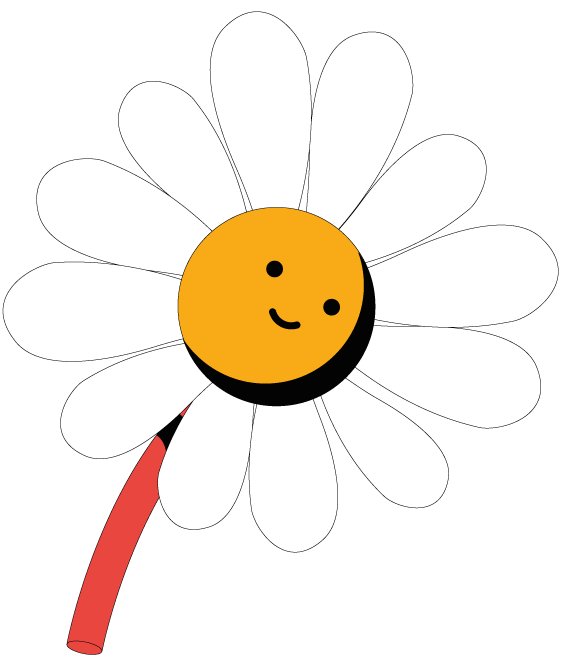
Coup de Blouse
Créée à l’initiative de l’APPA, Coup de Blouse propose des témoignages, des outils et des contacts utiles pour aider les internes et les praticiens, ainsi que leurs proches, à prévenir une situation à risque de souffrance au travail. Plusieurs ressources concernent les conflits à l’hôpital et les moyens existants pour les résoudre.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Praticien endocrinologue au centre hospitalier de La Rochelle depuis plus de trente ans, Dr Thierry Godeau s’est toujours engagé au sein de sa gouvernance, en particulier à travers la présidence de la Commission Médicale d’Établissement (CME). Depuis 2016, il représente ses homologues, issus de près de 800 hôpitaux du territoire, dans le cadre de la Conférence nationale des Présidents de CME de centres hospitaliers, une voix qui porte et qui compte dans toutes les réflexions et décisions concernant la politique de santé. A quelques mois de la fin de son mandat et de son départ en retraite, le médecin nous rappelle le rôle déterminant des CME dans le fonctionnement quotidien et l’attractivité du modèle hospitalier général, notamment en direction des nouvelles générations…
Quel est votre parcours ?
Je suis Rochetais d’origine et je suis devenu praticien hospitalier en endocrinologie après mes études de médecine à Poitiers puis mon internat à Nantes. J’y ai commencé ma carrière en tant que chef de clinique puis je suis revenu à La Rochelle à la faveur d’un poste qui se libérait. J’y exerce donc depuis plus de 32 ans et je prends ma retraite en 2027.
Pouvez-vous nous raconter votre engagement au sein de la CME de l’hôpital ?
De façon générale, je me suis toujours impliqué, à titre personnel, dans la vie associative, par exemple dans le monde du basket, à l’échelle de mon club puis dans les différentes instances au niveau local, régional ou national, pour le compte de la Fédération. Au niveau professionnel, j’ai toujours eu le même besoin de m’engager au service du collectif et ce dès le début de ma carrière à La Rochelle. J’ai rejoint différentes commissions de l’établissement, comme celle des gardes, que j’ai présidé pendant 8 ans. Cela m’a amené à me présenter à la vice-présidence puis à la présidence de la CME où j’ai été élu en avril 2007. Le mandat est normalement de huit ans mais, lorsque l’établissement fusionne, les compteurs sont remis à zéro, ce qui a été fois deux fois les cas ici pour constituer notre Groupe hospitalier Littoral-Atlantique (La Rochelle – Ré – Aunis).
Comment êtes-vous devenu Président de la Conférence des Présidents de CME de centres hospitaliers ?
C’est un peu la même logique : je me suis engagé… Il y a des instances au niveau des présidents de CME à l’échelle régionale ; chaque région envoie des élus au niveau national, ce qui constitue une sorte de conseil d’administration regroupant une soixantaine de présidents de CME. Nous représentons au total près de 800 hôpitaux, à l’exception des CHU, des centres hospitaliers spécialisés (CHS) ont leurs propres regroupements. Je suis devenu président en mars 2016, c’est un mandat de quatre ans renouvelable mais il a été prolongé à six durant la crise sanitaire car ce n’était pas le moment propice pour organiser des élections ! J’aurais donc « officié » pendant dix ans car ma fonction s’achève au premier trimestre 2026.
Pouvez-vous nous rappeler le rôle d’une Commission Médicale d’établissement ?
Concrètement, c’est une instance de médecins élus au sein de l’hôpital qui représente toutes les catégories de professionnels : praticiens, titulaires ou contractuels, chefs de service, chefs de pôle, etc. A l’exception des chefs de pôle, qui sont membres de droit, tous les médecins sont élus. C’est donc une instance représentative du corps médical hospitalier dans son ensemble, qui donne des avis sur l’ensemble des sujets concernant l’établissement : le projet médical, la stratégie, les budgets, les investissements, l’attractivité, la qualité des soins, l’organisation du travail, les filières, les parcours, l’accueil des étudiants, la recherche, etc.
La CME a toujours un avis consultatif mais, au regard de sa légitimité et sa représentativité, il est extrêmement rare que la direction aille à son encontre, en particulier sur la stratégie médicale portée par l’établissement.
Le président de la CME est élu parmi les membres de la Commission. Au-delà du fait qu’il préside l’instance, sa fonction l’amène en réalité à coordonner et piloter le projet médical, supervisant la qualité des soins et assurant un ensemble de co-décisions avec la direction, comme la nomination à certains postes (chef de pôle, chef de service) ou la stratégie qualité. Sur ces sujets, on n’est pas dans la consultation mais dans une vraie démarche de co-décision.
Les textes n’ont volontairement pas fixé de procédure d’arbitrage, ce que signifie que le Président de la Commission et le directeur de l’hôpital doivent forcément trouver un accord car l’un ne peut pas décider sans l’autre : cela les oblige à travailler ensemble. Sur certains sujets, comme les finances, il n’y a pas obligatoirement de co-décision, mais le Président de la CME est généralement impliqué dans les autres instances de gouvernance. Par exemple, comme tous les PCME, je suis membre à titre consultatif du Conseil d’administration et vice-président du directoire du GH.
Et au niveau national, quelles sont les prérogatives de la Conférence nationale ?
Pour schématiser, la Conférence est partenaire de toutes les négociations avec le Ministère, la HAS et l’ensemble de structures intervenant dans la politique de santé. J’ai participé par exemple aux négociations pour le Ségur de la Santé avec les syndicats et la Fédération Hospitalière de France. Et cette semaine, j’avais rendez-vous avec le conseiller de santé de l’Élysée puis j’ai été auditionné au Sénat sur le projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale (PFLSS).
Bref, on est sollicité en permanence sur tous les sujets concernant la stratégie de l’hôpital public, la gouvernance, le management, l’attractivité, l’organisation des soins notamment dans les territoires et les conditions du travail dans les centres hospitaliers que nous représentons.
Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
Il y en a beaucoup, et en permanence… On a travaillé récemment sur l’attractivité de l’hôpital, les conditions d’exercice ou le sujet des astreintes avec les syndicats. Il y a aussi la question du rôle des Présidents de CME une fois qu’ils ont terminé leur mandat, ou comment le système de santé peut capitaliser sur cette expérience acquise afin de favoriser l’organisation des soins sur le terrain ? Par exemple, avec la Conférence, on s’est beaucoup mobilisé en faveur des GHT qui constituent selon nous un levier pertinent pour redonner une dynamique à l’hôpital public malgré les difficultés actuelles.
De quelques moyens disposez-vous pour assurer tout ces missions ?
Évidemment, la fonction au niveau national requiert beaucoup de temps et, en ce qui me concerne, je passe près de la moitié de la semaine à Paris. On a une petite enveloppe de fonctionnement, qui n’est pas très importante, mais elle permet de prendre en charge un secrétariat et un peu de logistique. Ceci dit, on manque clairement de collaborateurs.trices, notamment sur des sujets techniques qui nécessitent des expertises particulières et des notes stratégiques. C’est un vrai sujet que l’on essaie de faire avancer. On a beaucoup pesé ces dernières années sur l’évolution des textes concernant la gouvernance et le rôle des Présidents de CME, en particulier sur le sujet des conditions et la reconnaissance des moyens. En effet, jusqu’à maintenant, beaucoup de Présidents étaient un peu isolés dans leur établissement à exercer cette fonction à côté de leur métier de médecin sans avoir nécessairement de temps dédié. Donc on a fait avancer les choses, notamment à travers une vaste enquête, réalisée en 2018 que j’ai eu l’occasion de remettre en personne à Agnès Buzyn. Elle a permis d’aller vers la charte de gouvernance au sein des établissements, qui doit reconnaître les moyens mis à disposition du Président de CME : temps disponible, secrétariat, moyens logistiques et, plus généralement, son positionnement en tant que représentant de l’établissement à l’extérieur et auprès de la direction.
Pour revenir à la question des moyens, on estime, en moyenne, qu’un Président de CME doit y consacrer au moins la moitié de son temps. En réalité, c’est du cas par cas mais ce n’est pas forcément corrélé à la taille de l’établissement ; en effet, dans le cadre d’une plus grosse structure, Il est plus facile de constituer une équipe autour de soi pour pouvoir déléguer et se consacrer aux sujets plus stratégiques, ceux qui nécessitent d’avoir du recul, de constituer des dossiers, de préparer des réponses, impossibles à faire entre deux consultations ou deux opérations !
On parle beaucoup des conditions de travail des médecins et des risques psycho-sociaux à l’hôpital. Quel est votre regard sur le sujet ?
C’est un sujet protéiforme et complexe qui est d’abord celui des syndicats. Mais comme il concerne aussi l’attractivité médicale, les Présidents de CME sont forcément impliqués :
si les conditions pour recruter des médecins ne sont pas remplies, il n’y a pas de médecin dans l’hôpital et l’hôpital ne tourne plus !
De façon générale, nous ne savons toujours pas très bien évaluer la charge de travail des médecins, ce qui est un premier sujet fondamental dans la mesure où c’est une profession dont les heures supplémentaires sont moins bien payées que les heures de travail normales. C’est une hérésie que l’on traîne depuis très longtemps et qui n’est toujours pas solutionnée alors que les attentes des nouvelles générations ont beaucoup changé. Pour les anciennes générations comme la mienne, on a sûrement accepté beaucoup de choses – peut-être un peu trop, au nom de la vocation et du « on n’est pas là pour l’argent »…
Or, aujourd’hui, le sujet majeur pour recruter est en partie liée aux rémunérations mais surtout aux conditions et à la reconnaissance de la charge de travail, ce qui implique d’abord d’avoir un dimensionnement convenable des équipes par rapport aux missions et aux besoins sur le terrain.
C’est un sujet sur lequel les jeunes sont beaucoup moins conciliants que nous et ils ont raison, car c’est un point déterminant de l’exercice qui a été laissé en jachère pendant de trop nombreuses années… C’est compliqué, mais il faut qu’on avance, en remettant les équipes au cœur des dispositifs. On a cru qu’on allait régler tous les problèmes avec les pôles, mais le moteur du réacteur de l’hôpital reste quand même l’équipe médico-soignante qu’il faut repositionner au centre de l’organisation.
Au-delà de la charge de travail, cela recouvre également le sujet de la capacité à décider. Si j’estime qu’on a bien fait avancer les choses pour la gouvernance au niveau dutop management, la situation s’est fortement dégradée en dessous…
Aujourd’hui, les médecins ont l’impression de ne jamais décider de rien !
Or, il faut qu’on réorganise cette décision en redonnant un peu de délégation et en répondant à des situations très concrètes : Quelles sont les marges de manœuvre d’un chef de service avec son cadre ? Quelles sont les marges de manœuvre d’un chef de pôle ? Quels sont les liens entre les deux et en définitive, quels sont les circuits institutionnels des décisions ? Il est nécessaire de clarifier tous ces circuits de décision et de faire avancer cela à l’échelle de l’établissement. Dans la loi RIST (2023), portée par notre nouvelle Ministre, il était justement question de remettre le projet de management et de gouvernance participatif au cœur du dispositif hospitalier mais, en réalité, cela n’a pas beaucoup avancé. Il y a beaucoup de résistance, ce qui renvoie à plusieurs problématiques, notamment au fait que les médecins ne sont pas bien formés au management. On a fait beaucoup de progrès, mais ce n’est pas encore satisfaisant. Et il y aussi un cercle vicieux car on a du mal, dans les CH, à trouver des volontaires pour prendre en charge des responsabilités de terrain, justement parce qu’ils ont aussi l’impression de ne rien pouvoir décider… La situation avance, il y a du mieux, mais c’est quand même très lent et ça va être un enjeu qu’il faudra continuer de porter dans les prochaines années, notamment à l’échelle de la Conférence, sur l’effectivité de cette gouvernance de proximité.
Malgré les difficultés, avez-vous un message à faire passer aux nouvelles générations de médecins sur l’exercice à l’hôpital ?
On ne va pas se mentir, les conditions sont parfois un peu difficiles.
Mais on est aussi en train de réorganiser l’hôpital, notamment à travers les GHT qui vont le rendre plus attractif, autour d’équipes territoriales permettant aux médecins de se recentrer sur leur cœur de métier.
Au-delà des problèmes, il y a des solutions et l’hôpital reste quand même un lieu d’exercice formidable, celui du travail en équipe, de l’expertise, des cas complexes et de la recherche. C’est aussi le lieu de la transmission du savoir car on y forme les jeunes et on a tous été formés par des anciens. A l’échelle des CME et de la Conférence, on travaille beaucoup en direction des jeunes, afin de mieux leur faire connaître le centre hospitalier « général », durant leur formation, car c’est un lieu d’exercice très différent du CHU et beaucoup moins hiérarchique. En ce sens, je pense que ce format d’établissement est très attractif et peut justement répondre aux attentes de nombreux jeunes médecins…
Rédacteur : Gabriel Viry, Directeur de l’agence KIBLIND.


