
45 ans de l’APPA : Marie Pezé et Nicolas Doudeau témoignent suite au symposium
A l’occasion des 45 ans de l’APPA, un symposium a été organisé à Antibes au congrès de psychiatrie SIP-SPH. Parmi les intervenants, Marie Pezé et Nicolas Doudeau nous partagent leur témoignage sur cet événement.

De gauche à droite : Nicolas Doudeau, Marie Pezé et Dr Jacques Trévidic.

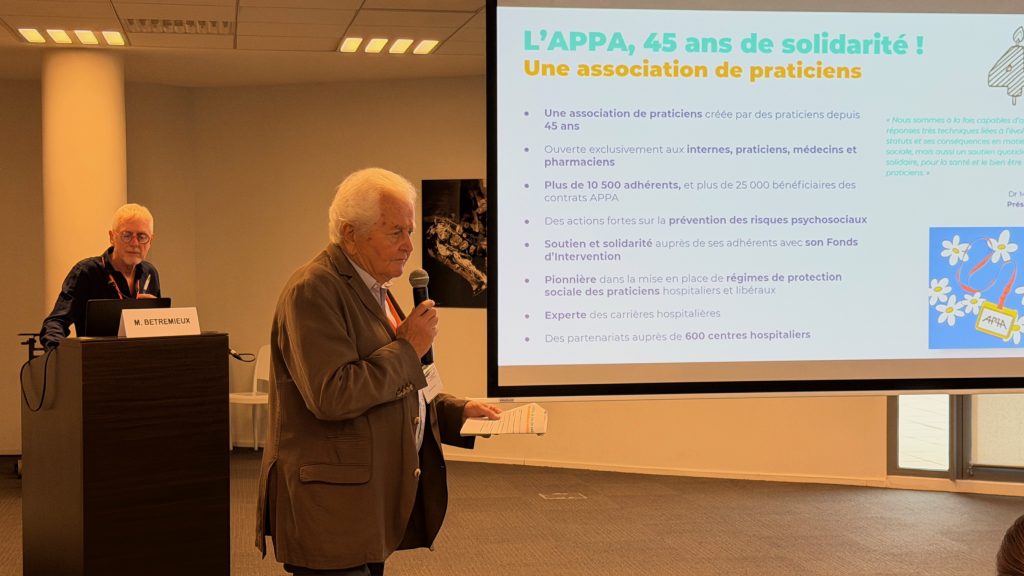
De gauche à droite : Dr Marc Bétrémieux et Dr Jean-Charles Pascal.
Témoignage de Marie Pezé
L’accélération du travail est un voleur de vie
Que dire sur le symposium de l’APPA sur « La crise de l’hôpital, quelle souffrance au travail, quelles solutions » le vendredi 3 octobre 2025, au cœur du congrès de psychiatrie dont le thème était la crise ?
Ce fut d’abord la joie des retrouvailles avec la fine équipe des praticiens bénévoles qui font vivre cette association comme je fais vivre le réseau des consultations Souffrance et travail. La joie devant le travail commun, le travail collectif devant la santé dégradée de nos pairs, des patients en général.
La joie aussi de constater que partout dans les territoires émergent des réseaux de prise en charge qui se mobilisent sans tout attendre des institutions, trop défaillantes. APESA pour les chefs d’entreprise, HELPEN pour l’Éducation nationale, SPS pour les soignants, Souffrance et travail et tant d’autres que je ne peux citer pour tous ceux qui se sentent seul, petit et sans arme devant le rouleau compresseur des nouvelles organisations du travail.
Les soignants, comme tant d’autres professionnels, que l’on a ponctuellement applaudi à nos fenêtres, évoquent depuis des années le manque d’effectifs, les flux tendus, les statuts précaires et l’épuisement devant des soins dégradés, l’intensification du travail, la perte de l’autonomie. L’injonction « au travail à tout prix pour sauver des vies » s’est déployée dans un environnement professionnel tout aussi dégradé qu’avant par le manque de masques, d’EPI, de matériels de ventilation, de kits et réactifs pour les tests diagnostic, de produits de sédation, de temps, de compétences, de perspectives sur la durée de l’investissement.
Si les soignants ont tenu, c’est aussi grâce aux retrouvailles avec le travail collectif, l’autonomie de décision dans les soins, la mise au rebut temporaire du chiffrage constant de l’activité, le retour à l’inventivité, au sens du soin. Le retour à une autonomie procédurale et au sens du travail a, comme par miracle, rendu leur énergie aux soignants épuisés confirmant ce que disent les cliniciens du travail : le terreau du burn-out chez les soignants n’est pas tant la charge de travail que la perte de sens du soin et la souffrance éthique de mal faire son travail. Il faudrait tirer ces leçons de cette période inédite.
Malheureusement, l’exemplaire construction collective que le monde des soignants a mis en œuvre par temps de pandémie, s’est dissoute dans le retour frénétique au monde d’avant, celui des tableaux de bord, de la santé réduite aux algorithmes dont on a vu qu’ils étaient sans effet sur le COVID.
Le retour « à l’hôpital d’avant », s’il signifie la fin de la visibilité des héros du moment, a été ressenti comme un abandon, un mensonge, voire une trahison. Or, celle-ci peut conduire à des effondrements psychiques ou physiques.
Beaucoup se sont interrogés, lors de cette table ronde sur les raisons de cette dégradation : certains ont produits de remarquables études chiffrées sur l’état des internes comme le Président de l’AFFEP Nicolas Doudeau, d’autres ont enfoncé le clou de la médiation des conflits comme le docteur Jacques Trévidic, tandis que les fondateurs rappelaient les missions fondatrices de l’APPA.
Je resterai sur cette idée de crise qui n’en est pas une, mais qui déclenche nos crises psychiques, physiques, sociales.
Car voici qu’arrivent dans nos consultations, les cadres sup, les managers de projets, les directeurs généraux, les DAF, les directeurs d’hôpitaux, les médecins… Tous ces grands professionnels à la personnalité solide, si sûrs de leur métier, de leur implication, corps et âme, si identifiés à leur entreprise, à leur institution, s’essouffleraient donc, eux aussi ?
Eux aussi racontent qu’ils vont travailler à reculons depuis quelque temps, la peur au ventre. Qu’on leur demande de faire de « sales petites choses », qu’ils ont mis en place les systèmes de pilotage, qu’ils contrôlent tout en temps réel, qu’ils contrôlent en fait un travail théorisé, faussement objectif, qu’il faut désormais tricher sur les résultats, sur les bilans pour légitimer ce système devenu fou. Ou bien rajouter plus de normes, de procédures, de contrôles. Qu’ils sont épuisés par la charge de travail et la perte du sens de ce qu’ils font.
Celui qui s’en sort dans les organisations actuelles du travail n’est pas, comme autrefois, le plus fort, le plus intelligent, mais le plus rapide. L’augmentation de la cadence des tâches à accomplir est présente partout, dans tous les secteurs professionnels, à des niveaux d’intensification qui pulvérisent les seuils neurophysiologiques et biomécaniques.
Les effets de l’hyperactivité sur la santé sont connus : épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, de l’éveil, de l’attention, de la concentration, de la mémoire. Troubles cardio-vasculaires, mort subite au travail, accidents, conduite addictive, suicides…
L’organisme humain a des cycles, des alternances de veille et de sommeil, des pics de production de certaines hormones. Si on soumet l’organisme à une intensification des tâches sur un temps trop prolongé, il fabrique des toxines, il doit mobiliser beaucoup de cortisol pour tenir, il sur-fonctionne en permanence.
Ce corps inoxydable, ce « corps machine » que veut l’organisation du travail, n’existe pas. Ce corps-là est un moyen, juste une force motrice.
Le nôtre est une origine.
Sans véritable moyens ou concepts permettant la déconstruction de la mise en œuvre de la casse de l’hôpital, Le burn-out a surgi comme un mot-valise mis à toutes les sauces. Nos « athlètes/ esclaves de la quantité » font des syndromes d’épuisement professionnel s’actualisant sous des formes diverses dont la terminologie de burn-out ne rend pas compte suffisamment finement, au risque de devenir comme le harcèlement moral, un nouveau concept poubelle : on peut ne pas arriver à mettre le pied à terre un matin, ou bien faire un AVC, ou trouver la fenêtre derrière le bureau du N+1 bien tentante, ou exploser en sanglots dans une réunion.
On qualifiera le burn-out de syndrome de désadaptation à des organisations du travail pathogènes, à l’accélération frénétique de nos fonctionnements neurophysiologiques, bref à un des aspects de la psychopathologie des violences collectives définie par F. SIRONI.
Le burn-out est de surcroît dans une phase de récupération médiatico-sociale qui écrase la possibilité de faire un diagnostic nuancé. D’autres tableaux cliniques liés au travail existent mais sont méconnus, au profit d’intitulés venus d’ailleurs, bore out, Brown out. Rajoutons que la CPAM ne reconnait que les troubles suivants hors tableau : trouble anxieux généralisé, dépression, stress post-traumatique).
Certains dans la salle s’étonnaient de la gravité des décompensations, se souvenant qu’ils travaillaient de façon forcenée dans leur jeunesse, s’interrogeant sur le manque d’engagement peut-être des nouvelles générations.
- C’est oublier que le travail en mode dégradé, est le terreau de l’épuisement professionnel ;
- Procéduraliser à outrance le travail asphyxie le travailleur sous des tâches de traçabilité, de reporting ;
- Travailler de façon trop séquencée, sans vision du produit fini, entraîne une perte de sens de son travail ; cette taylorisation a envahi tous les métiers ;
- Travailler à la limite du « mal faire » et de l’illégalité, sans les moyens, le temps, les effectifs, génère des souffrances éthiques surtout lorsque la sécurité du patient est impliquée ;
- Donner trop de travail permet d’obtenir un surcroît de productivité mais place le travailleur dans une hyperactivité compulsive qui l’empêche de penser à son état.
Le corps peut démissionner si le déséquilibre entre temps biologique et temps du travail est trop grand. Derrière le bruit des machines, il y a le silence des hommes, dit Jean Auroux qui a tant œuvré pour y mettre fin. Le bruit feutré des mains qui règlent, ajustent, conçoivent, réparent, pas très loin d’ici, les mains des compagnons du devoir qui reconstruisent Notre-Dame. Honorons le travail avant qu’il ne soit trop tard.
Marie Pezé, psychanalyste et fondatrice du réseau Souffrance et Travail
Témoignage de Nicolas Doudeau
J’ai eu la chance de participer au symposium de l’APPA, notamment sur la souffrance au travail, permettant de mettre en avant le mal-être des internes à travers la présentation des résultats de l’enquête sur la santé mentale des étudiants en médecine en 2024, puis de propositions de solutions, avec en première solution possible et simple, l’application de la “Loi dans nos internats”.
L’échange qui m’a le plus marqué vient de l’ancien président de l’APPA, Dr Jean-Pierre Provoost, qui a pu décrire que cette enquête lui permettait de voir plus clairement ce phénomène du mal-être des internes, difficilement perceptible à cause de l’habituation que nous avons dans nos hôpitaux à notre cadre de travail, trop souvent maltraitant les usagers et les soignants. Mais surtout que ce phénomène n’est pas nouveau et qu’il faut qu’on continue de lever le voile sur tous ces phénomènes.
Nicolas Doudeau, Interne en Psychiatrie et Président de l’Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie (AFFEP)
L’APPA remercie chaleureusement Marie Pezé et Nicolas Doudeau d’avoir pu intervenir lors de ce symposium organisé pour les 45 ans de l’APPA.


